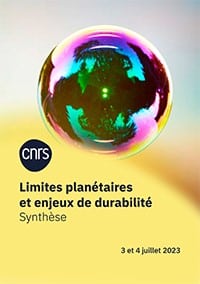Comprendre les changements globaux, affronter les défis de leur impact, explorer les scénarios d’un monde futur sont depuis toujours dans les priorités de la recherche scientifique. Avec l’objectif d’impliquer toutes les disciplines et d’associer tous les acteurs et porteurs d’enjeux à la discussion scientifique, le CNRS et France Universités organisent cette année des rencontres sur les « Limites planétaires et enjeux de durabilité ».
Cet événement a eut lieu les 3 et 4 juillet 2023 à Paris – il s’inscrit dans la suite des rencontres de Marseille de mai 2022. Il a été suivi des rencontres FutureEarth, focalisées sur la transformation des pratiques, les 28 et 29 juin à Marseille.
Cette année, ces journées ont été organisées dans un format s’adressant a un public varié : la première journée visera à introduire et débattre quatre sujets transverses avec un public scientifique le plus large possible en montrant des complémentarités et questionnements divers, tandis que la deuxième journée sera l’occasion d’approfondir ces sujets lors d’ateliers rassemblant des chercheurs et chercheuses de toutes les disciplines.
Interviews des intervenants du colloque
La synthèse du colloque
Consulter le programme
Artificialisation des sols et extraction des sous-sols : des défis pour la transition écologique
Le sous-sol a plusieurs utilisations comme la production d’énergie via la géothermie, le potentiel de stockage géologique (CO2, méthane, hydrogène) et de production de gaz (hélium, hydrogène), l’extraction de ressources minérales dont certaines essentielles à la construction d’infrastructures de production d’énergies renouvelables (terres rares pour les aimants des éoliennes, métaux et silice des panneaux photovoltaïques, lithium pour les batteries des voitures électriques, etc.). Il est aussi crucial au transport d’énergie, de fluide ou de personnes dans un contexte d’urbanisation croissante. Toutes ces utilisations seront décuplées dans le futur, en particulier dans le contexte de la transition énergétique. Elles pourraient entrer en compétition avec d’autres utilisations, notamment l’approvisionnement en eau. Il est alors absolument nécessaire d’analyser les évolutions attendues afin d’anticiper les enjeux environnementaux et socio-économiques, et garantir son statut de bien commun. Il est également impératif d’interroger le lien entre science, société et industrie : analyser comment l’information circule à travers les différents acteurs et comment elle est comprise, étudier comment prendre en compte l’aspiration des citoyens et ne pas juste leur expliquer a posteriori l’intérêt d’une démarche d’exploitation du sous-sol, analyser les dimensions législatives et juridiques qui lui sont associé.
Sobriété et enjeux technologiques : vers quelle durabilité ?
Nos sociétés modernes consomment les ressources de la terre sans se poser la question de leurs limites, ce qui pose clairement le problème de la durabilité de nos modes de vie. En termes d’exemple non exhaustif, on estime que la quantité de gaz à effet de serre émise par le secteur du numérique augmente de 6 % par an. Et une étude récente de l’Ademe indique que les effets sur les ressources (métaux et fossiles) concentrent 52 % de l’empreinte du numérique en France, les émissions de gaz à effet de serre seulement 11 %. La diffusion massive des technologies dans la société peut ainsi représenter un choc environnemental pour la planète. La recherche d’approches méthodologiques scientifiques sobres ou frugales qui utilisent, avec modération ou à un niveau minimal, les ressources énergétiques ou les matières premières (dans leur fabrication comme dans leur fonctionnement), ouvre de nouvelles voies et de possibilités pour la science et pour la société. Cependant, ces recherches peuvent induire des effets indirects et rebonds, qui deviennent contre-productifs en aboutissant à un dépassement des consommations initiales et en limitant les bénéfices environnementaux des nouvelles approches scientifiques. L’enjeu est de développer une réflexion sur le concept de sobriété, et des équilibres à trouver entre la recherche scientifique visant des systèmes moins consommateurs en ressources et les recherches visant à la réduction des usages.
Vers une raréfaction de la ressource en eau : comment accompagner les transitions ?
Suite à plusieurs épisodes de sécheresse, ayant provoqué des situations de pénuries dans certaines régions françaises, et touchant tous les usages (eau potable, agriculture, industrie, loisir), la question de la disponibilité l’eau et de sa renouvelabilité est devenue un enjeu crucial sur le territoire français, alors même que, jusque-là, chacun se représentait cette ressource comme abondante sans réellement se soucier de sa disponibilité et des milieux. Dans un contexte de changement global, les ressources en eau sont non seulement soumises à des pressions liées au dérèglement climatique mais aussi aux activités humaines, qui nécessitent d’être interrogées dans une approche globale plus systémique et intégrée, associant les enjeux de quantité et de qualité. Les trajectoires globales, décrites dans les derniers rapports du GIEC, prédisent notamment une exacerbation de phénomènes climatiques extrêmes, dont des sécheresses et des inondations, et incitent à favoriser des usages plus sobres. Mais, les prévisions régionales et saisonnières doivent aussi être considérées et intégrer la singularité des territoires, des usages et des acteurs concernés dans leur diversité afin d’envisager des modèles de développement locaux les mieux adaptés et d’accompagner les acteurs et les usagers vers des pratiques viables, plus durables et équitable. Comment les dernières connaissances produites sont-elles prises en compte pour accompagner les transitions nécessaires et être à la hauteur de la diversité des enjeux ? Seules, les mesures de sobriété ne peuvent être envisagées sans considérer les impacts sociaux, économiques, environnementaux, techniques dans les territoires et à toutes les échelles. La question des valeurs et des limites de cet élément vital est alors posée et la notion de commun soulevée. Cela interroge le rôle des différents acteurs, qu’ils soient scientifiques, décideurs, gestionnaires, entrepreneurs, habitant ou citoyen, dans la co-construction de réponses durables à ces enjeux majeurs, environnementaux et de société.
Pollution chimique : quels liens avec l’extinction de la biodiversité ?
Ces 30 dernières années ont vu émerger la possibilité d’une société reposant sur un apport carboné biosourcé en lieu et place du carbone fossile, ce changement de paradigme étant un élément déterminant pour atteindre la neutralité carbone à l’horizon du 21ème siècle.
L’émergence des concepts de chimie verte, de chimie durable, d’éco-extraction, de bioraffinerie ou encore de chimie du végétal a stimulé la recherche fondamentale pour alimenter des processus d’innovation radicale plutôt qu’incrémentale visant à apporter des réponses scientifiques à certains des grands enjeux planétaires. Cette dynamique doit permettre de concevoir et découvrir de nouveaux produits chimiques, procédés de production ainsi que des pratiques de gestion de produits qui amélioreront la performance et augmenteront la valeur de ces produits, tout en répondant tant aux principes de la transition qu’elle soit écologique, technologique, énergétique, économique et/ou sociale qu’aux objectifs d’écoHealth -protection de la santé humaine, de l’environnement et de la biodiversité. Ce processus dynamique d’innovation a accompagné le changement de modèle de certains acteurs de l’industrie chimique pour réduire leur dépendance vis-à-vis des ressources fossiles ainsi que l’impact de leurs activités par l’introduction graduelle de matières premières biosourcées. Néanmoins, un certain nombre de questions importantes demeurent en matière d’impact environnemental et d’éco-toxicité des nouveaux produits biosourcés, en matière de production intensive de biomasse et d’anthropisation des sols, du potentiel de solutions bio-inspirées ou encore d’équilibre entre valorisation de la biodiversité et pression sur cette dernière. Ajouter une phrase pour faire le lien avec les intervenants lorsqu’ils seront fixés.